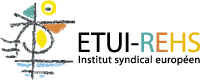Le travail : une fenêtre d’exposition à des risques multiples
|
|
|
Donner naissance à un enfant malformé, faire une fausse couche, éprouver des difficultés à avoir des enfants, être atteint d’impuissance sont autant de drames personnels vécus dans l’intimité des couples et des familles. Des drames dont les causes sont généralement perçues comme individuelles, parfois familiales ou génétiques. Il est exceptionnel que les conditions de travail des victimes de troubles de la santé reproductive soient interrogées.
Et pourtant, les lieux de travail représentent une fenêtre d’exposition à une très longue liste d’agents toxiques pour la reproduction, parmi lesquels figurent les substances chimiques (métaux lourds, pesticides, solvants, perturbateurs endocriniens, etc.), les facteurs physiques (chaleur excessive, radiations ionisantes, etc.), psychologiques (stress) et ergonomiques (charges lourdes, travail de nuit ou posté, etc.).
De récentes études tendent à confirmer l’impact majeur de l’exposition professionnelle aux substances chimiques, non seulement sur les différents aspects de la vie reproductive des travailleurs et des travailleuses mais également sur la santé de leurs enfants.
|
| |
La législation communautaire : un ensemble incohérent et inefficace
|
|
|
En matière de risques reproductifs, il faut distinguer dans la législation communautaire deux grandes catégories : la première réglemente la mise sur le marché des produits chimiques, la seconde assure la protection de la santé des travailleurs.
Les règles du marché ont été adoptées pour permettre à l’industrie chimique de faire circuler sa production à l’intérieur du marché communautaire. Les exigences de santé et de protection de l’environnement n’y jouent qu’un rôle limité. Force est de constater que la majorité des substances présentes sur le marché n’ont jamais été testées par rapport à leur impact potentiel sur la santé reproductive. Par conséquent, le nombre de substances classées « toxiques pour la reproduction » est limité. De nombreux utilisateurs, privés ou professionnels, peuvent donc acheter des produits dont ils ignorent totalement les risques pour leur santé reproductive.
La législation européenne qui garantit la protection des travailleurs ne prévoit aucune protection spécifique contre les facteurs de risques pour la reproduction. Cette protection est censée être assurée par une série de directives s’adressant à certaines catégories de travailleurs (les travailleuses enceintes) ou à des risques spécifiques (les radiations ionisantes). Depuis 2002, la Commission annonce qu’elle envisage d’étendre aux substances toxiques pour la reproduction le champ d’application de la directive Agents cancérigènes, qui définit une hiérarchie précise d’obligations en matière de prévention sur les lieux de travail. Au grand dam des organisations syndicales, les développements les plus récents nous font craindre un revirement de la Commission.
|
| |
La directive Travailleuses enceintes : bien peu protectrice
|
|
|
La directive Travailleuses enceintes a été adoptée en 1992. Le volet consacré à la protection de la maternité est très insuffisant. Les mesures de prévention à prendre par l’employeur sont très imprécises. Elles ne permettent pas de protéger l’enfant à naître au cours des premières semaines de grossesse, et encouragent l’écartement de la femme enceinte plutôt que l’élimination du risque et la prévention à la source. Par ailleurs, contrairement aux autres directives concernant la santé au travail, la directive Travailleuses enceintes ne prévoit aucune consultation de la représentation des travailleurs sur les mesures de prévention. La révision de cette directive est en cours. Malheureusement, la Commission refuse de toucher aux mesures portant sur l’organisation de la prévention.
|
| |
|
|
|
- Produire et reproduire. Quand le travail menace les générations futures
Mengeot, M-A, Vogel, L., ETUI-REHS, 2008
- La santé des femmes au travail en Europe. Des inégalités non reconnues
Vogel, L., BTS, 2003
-
Nouvelle convention sur la protection de la maternité à l'OIT
Newsletter du BTS, juin 2000
- La transposition de la Directive 92/85/CEE relative à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (I)
Newsletter du BTS, juin 1997
- La transposition de la Directive 92/85/CEE relative à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (II)
Newsletter du BTS, décembre 1997
|
| |
Documents complémentaires
|
|
- Potential developmental neurotoxicity of pesticides used in Europe
Environmental Health, October 2008
- Occupational exposure to organic solvents: effects on human reproduction
The Health Council of the Netherlands, June 2008
- Declines in Sex Ratio at Birth and Fetal Deaths in Japan, and in U.S. Whites but Not African Americans
Environmental Health Perspectives, 2007
- Valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour les substances reprotoxiques
Afsset, avril 2007
- Developmental neurotoxicity of industrial chemicals
The Lancet, 2006
- Workgroup Report: Implementing a National Occupational Reproductive Research Agenda—Decade One and Beyond
Environmental Health Perspectives, March 2006
- Occupational risk factors and reproductive health of women
Occupational Medicine, 2006
- Les expositions aux produits mutagènes et reprotoxiques
DARES, Enquête SUMER, août 2005
- How strong is the evidence of a link between environmental chemicals and adverse effects on human reproductive health?
British Medical Journal, February 2004
- Collaboration is needed to co-ordinate European birth cohort studies
International Journal of Epidemiology, 2004
- An Occupational Reproductive Research Agenda for the Third Millennium
Environmental Health Perspectives, April 2003
- Critical windows of exposure for children’s health: cancer in human, epidemiological studies and neoplasms in experimental animal models
Environmental Health Perspectives, 2000
- Chemical Trespass: A toxic legacy
A WWF-UK Toxics Programme Report, July 1999
- An anthropological approach to the evaluation of preschool children exposed to pesticides in Mexico
Environmental Health Perspectives, 1998
- Reproductive and developmental toxicants
Report to the chairman, Committee on Governmental Affairs, U.S. Senate United States, 1991
- Paternal exposure to mercury and spontaneous abortions
British Journal of Industrial Medicine, 1991
|
| |
|
|
|
- Eurocat. Réseau européen d’enregistrement des anomalies congénitales
- Site web de la Commission européenne sur les perturbateurs endocriniens
- Scorecard - liste des substances toxiques pour la reproduction et le système endocrinien
Environmental Defense Fund
- Site web consacré aux perturbateurs endocriniens par les auteurs du livre Our Stolen Future
- Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction (CERHR)
National Toxicology Program, U.S. Government
- Programme de recherche de l'Institut américain de santé au travail
- Bibliographie sur les risques reproductifs liés au travail
|
| |
L'étiquetage des produits toxiques pour la reproduction ne protège pas les utilisateurs
|
|
|
| |
|
 |