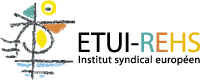|
Après le Sénat français en octobre 2005, l'Assemblée nationale vient de rendre sa copie sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante. Un nouvel état des lieux assorti de nombreuses propositions.
Les députés ont présenté le 23 février le rapport de leur mission d'information sur les risques et les conséquences de l'exposition à l'amiante avec 51 propositions à la clé. Ils ont tenté d'envisager les différents axes de la problématique en se penchant sur la prise en charge des victimes, les procédures judiciaires, le désamiantage, la prévention, la situation mondiale (avec un arrêt sur l'actualité du Clemenceau).
-
Indemnisation des victimes. Les députés ont soulevé la nécessité de faire évoluer la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) vers une réparation dite intégrale. Fondé sur un compromis établi entre syndicats et patronat en 1898, ce système de réparation non contentieux instaure une indemnisation forfaitaire et non une indemnisation intégrale comme dans le cas d'un accident de la vie courante.
«Comment la société française du XXIe siècle peut-elle comprendre qu'un même préjudice corporel, entièrement indemnisé s'il résulte d'un accident de la route, le soit deux fois moins quand il est provoqué par le travail», s'interrogent les députés. Ceux-ci estiment indispensable que l'Etat double, au moins, sa participation financière au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata). Dans le cadre de la réforme de tarification de la branche, ils suggèrent une modulation des cotisations des employeurs en fonction de leurs efforts de prévention.
-
Les actions en justice. Ces dernières années, de très nombreux ouvriers contaminés ont obtenu la réparation intégrale en faisant valoir, devant les tribunaux, la "faute inexcusable" de leurs employeurs. Pour les députés, cette démarche contentieuse ne peut cependant être la norme. Dans leur rapport; les députés remettent en cause la définition juridique de la «faute inexcusable» qu'ils jugent «artificielle». Ils préfèrent favoriser une indemnisation par la sécurité sociale, après une amélioration de la réparation des AT-MP sur le montant des indemnisations, plutôt qu'une action judiciaire, et ils proposent donc une redéfinition de la faute inexcusable en «faute d'une particulière gravité» dont les critères seraient plus restrictifs. Cette définition donnerait la «possibilité de poursuivre un employeur particulièrement fautif», précise le rapport. Ce qui fait bondir l'Andeva et le Comité antiamiante Jussieu. «Une telle régression sociale, qui constitue une véritable spoliation des victimes, serait proprement inacceptable», préviennent-ils.
Les députés se montrent par contre plus favorables aux procédures pénales impulsées par les victimes. Ils considèrent que la demande d'un procès pénal «répond à une quête légitime de la vérité et à un souci d'exemplarité». Or force est de constater que le parquet est particulièrement inactif sur les dossiers de santé publique. Les députés souhaitent donc "donner des outils juridiques" aux victimes pour qu'elles fassent valoir leur point de vue. Ils proposent ainsi que les parties civiles puissent former un pourvoi en cassation contre un arrêt de non-lieu, afin que les dossiers de l'amiante ne soient plus systématiquement enterrés. Les députés soulignent par ailleurs les "difficultés d'application" de la loi Fauchon en matière de risques professionnels, qui ont abouti au prononcé de plusieurs non-lieux. Adoptée le 10 juillet 2000 afin de limiter les poursuites pénales à l'encontre des décideurs publics en cas d'homicides ou de blessures involontaires, la loi Fauchon impose, en matière de responsabilité civile, qu'ait été violée "de façon manifestement délibérée" une obligation particulière de prudence ou de sécurité légale ou réglementaire pour qu'il y ait condamnation. Les députés souhaitent supprimer la référence à un acte "délibéré".
-
Désamiantage. Les députés ont souligné que nombreuses étaient les critiques sur la mauvaise qualité des diagnostics et que le secteur souffrait d'une distinction entre matériaux friables et non friables, ce qui est source de négligence quant à la sécurité des travailleurs et de la population. Ils pointent également les risques pour les métiers de la maintenance dans lesquels les travailleurs ne sont pas assez informés des dangers d'inhalation inopinés, ou encore le mauvais traitement des déchets d'amiante. Les députés proposent notamment : la création d'un registre centralisé des «diagnostics amiante» de tous les bâtiments, accessible à tous ; une certification obligatoire pour tous les intervenants dans la gestion du risque amiante, la formation au risque amiante de tous les ouvriers du bâtiment... Des avancées «considérables», saluent l'Andeva (Association nationale des victimes de l'amiante) et le Comité antiamiante Jussieu.
-
La prévention. La mission déplore le manque de moyens de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) pour une bonne évaluation des substances chimiques. Elle suggère aussi de revoir le rôle et les missions des médecins du travail, "sentinelles capables d'alerter sur la santé au travail". La mission a encore estimé que la France n'est "pas à la hauteur des besoins" en matière de recherche, prévention et de médecine du travail". Elle insiste ainsi sur la nécessité de "placer la santé au travail au coeur de la santé publique".
-
Abolition mondiale et démantèlement des navires. La mission parlementaire s'est enfin prononcée pour une abolition mondiale de l'amiante, dénonçant les «pratiques duales d'entreprises européennes qui continuent d'utiliser de l'amiante dans des pays tiers» via des filiales. «L'objectif, pour les députés, est d'interdire partout l'usage et la commercialisation de d'amiante» car l'usage intensif qui se poursuit ailleurs est une «bombe à retardement». Ceux-ci préconisent un traité international, du même type que celui élaboré pour l'interdiction mondiale des mines antipersonnel. Revenant sur l'affaire du Clemenceau, les députés proposent de développer une filière technologique française de démantèlement des navires en fin de vie. "Ce qui a été possible pour le traitement des déchets nucléaires avec la Hague doit pouvoir l'être également pour les bateaux", estime le rapporteur.
La mise en application des cinquante et une recommandations est désormais entre les mains du groupe d'études consacré à l'amiante à l'Assemblée nationale.
Le département "Santé et Sécurité" de l'ETUI-REHS a été auditionné par la mission en décembre 2005. Il a contribué à fournir des éléments d'information concernant l'évolution de la politique communautaire et la situation de l'amiante dans le monde.
Sources: Le Journal de l'Environnement, Le Monde, Libération, Le Nouvel Observateur.
|