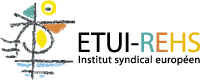|
« Conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs du Québec » est un rapport publié par l’IRSST. Il a été écrit par Michèle Gervais, Paul Massicotte et Danièle Champoux.
Ce rapport est basé sur une analyse des données de l'Enquête générale sur la santé et le bien-être de la population, menée en 1998 par l'Institut de la statistique du Québec (ESS98). Il permet de brosser un tableau sectoriel et professionnel de ces conditions organisationnelles et physiques. Il documente le cas particulier des petites entreprises, élabore des indicateurs, puis tente d'analyser l'exposition aux contraintes, déterminées selon l'âge et le sexe des travailleurs.
Le rapport permet de mieux comprendre les liens potentiels entre la santé et la sécurité au travail (SST) et les conditions de travail et d’emploi. L’enquête, menée auprès d’un échantillon (11 000 travailleurs) représentatif de la population québécoise, a fourni un matériel inédit et intéressant sur ces différents aspects ainsi que sur les accidents du travail. Les informations traitées ne tiennent pas compte de la gravité des accidents du travail, seulement de leur fréquence.
On sait que le risque de subir un accident est plus élevé chez les travailleurs manuels en raison des particularités de leurs tâches et de leur environnement de travail, mais l’enquête révèle que la fréquence des accidents augmente au fur et à mesure que le nombre cumulé de contraintes physiques s’accroît. Ainsi, les travailleurs sans exposition aux contraintes physiques examinées montrent un taux de fréquence d’accident de 1,1% alors que ceux qui sont exposés à trois, quatre, cinq ou six contraintes ou plus montrent des taux de 7%, 9%, 10% et 12% respectivement. On remarque aussi que, parmi les caractéristiques organisationnelles investiguées, les horaires de nuit et les longues semaines de travail (41 heures et plus) sont associés aux plus fortes fréquences d’accident. Cependant, ces caractéristiques horaires se rencontrant dans des secteurs où les contraintes physiques sont nombreuses, on ne peut établir de lien particulier entre les contraintes organisationnelles et la survenue d’accidents du travail, bien que la diminution de la vigilance, la fatigue et la durée de l’exposition puissent être en cause dans les accidents.
Le bilan des accidents du travail dans l’ESS98 diffère de celui tiré des statistiques d’indemnisation de la CSST. Ainsi, la fréquence des accidents du travail dans le secteur de la restauration, rapportée à l’équivalent d’effectifs de travailleurs à temps complet, dépasse celle des secteurs primaires et manufacturiers. Selon cet indicateur, les secteurs du commerce de gros et de la construction présentent le même niveau de risque, alors que les secteurs de la santé et services sociaux, des loisirs, hébergement et autres services, et du commerce de détail présentent un risque d’accident supérieur à celui du secteur du transport et entreposage (la gravité n’est pas prise en compte). L’émergence des secteurs tertiaires comme porteurs de risques à la SST semble donc confirmée par ces résultats.
Les jeunes de moins de 25 ans constituent une population à haut risque. Non seulement plus souvent accidentés que les travailleurs de 25 ans et plus, ils sont aussi significativement plus exposés aux contraintes physiques et organisationnelles. Compte tenu de cette surexposition (à presque toutes les contraintes considérées dans l’enquête) et du lien établi entre le cumul de contraintes et le risque de subir un accident, il est difficile de fermer les yeux sur cette composante de la fréquence des accidents chez les jeunes travailleurs, indépendamment des questions liées à l’apprentissage et la prévention auprès d’une population peu expérimentée.
Les secteurs tertiaires qui se démarquent par de relativement fortes fréquences d’accident, se caractérisent en majorité par des conditions de travail précaires : travail temporaire, temps partiel, travail autonome, sous-traitance, faible revenu, faible syndicalisation, faible ancienneté.
L’absence de contrôle sur le travail, élevée dans ces conditions d’emploi, est associée à une plus forte fréquence d’accident au travail.
En ce qui concerne la taille de l’entreprise, les plus petites (1-20 employés) s’avèrent être des concentrateurs de conditions de travail et d’emploi précaires : c’est ici que la moitié des jeunes travaillent; le temps partiel et le travail temporaire sont très courants; l’ancienneté et la syndicalisation sont faibles tout comme les revenus. Les secteurs des loisirs, hébergement, services personnels et domestiques, de la restauration et du commerce de détail y sont surreprésentés.
On y retrouve également les trois quarts des travailleurs autonomes. Plus soumis que les salariés aux contraintes organisationnelles, ils travaillent aussi huit heures de plus chaque semaine. Pour ce qui est des contraintes physiques, dans les secteurs primaires et de la construction notamment, les travailleurs autonomes – oeuvrant comme sous-traitants de grandes entreprises – sont plus exposés que les salariés aux efforts physiques, aux vibrations d’outils et de machines et aux poussières de bois. Le risque d’accident est d’autant plus élevé.
En somme, les résultats de cette étude convergent pour indiquer que des populations spécifiques, généralement moins ciblées par les programmes de prévention, nécessitent une attention particulière en matière de prévention des accidents du travail et, de façon plus globale, d’amélioration de leurs conditions de travail.
Source: IRSST
|