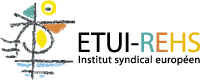|
27/10/2005.
La mission commune d'information du Sénat français sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante a rendu le mercredi 26 octobre ses conclusions dans un rapport intitulé Le drame de l'amiante en France dans lequel elle a formulé 28 propositions. De 1965 à 1995, se sont 35.000 décès qui sont imputés à l'amiante, un chiffre qui va gonfler avec les prochaines années puisque les estimations tablent sur 60.000 à 100.000 décès dans les 20 à 25 ans à venir. Un quart des retraités masculins auraient été exposés à la fibre cancérogène selon l'Institut de veille sanitaire (INVS). "La mission a essayé de comprendre comment cette tragédie a pu avoir lieu sans forcément juger les acteurs. Nous avons tout de même relever l'inertie des pouvoirs publics, la passivité des organismes de santé et le rôle des lobbies qui ont anesthésié l'Etat, dans un contexte où les conséquences sanitaires étaient connues", souligne Jean-Marie Vanlerenberghe, président de la mission.
Les dangers de l'amiante ont en effet été mis en avant en 1906 quand les premiers cas de fibrose sont découverts chez les ouvriers des filatures. «Dès 1965, on en savait assez et les risques sanitaires étaient biens connus des industriels et de l'administration», assure Gérard Dério, rapporteur. Le rôle des organismes de santé a également été examiné. Si le sénateur souligne un rôle ambigu de l'Institut national de sécurité et de recherche (INRS), il note qu'il n'avait aucune obligation d'alerte des pouvoirs publics à ce moment, puisqu'elle date seulement de la loi de sécurité sanitaire de 1998 qui a marqué la création de l'INVS. C'est surtout le rôle de l'ancien directeur de l'INRS, Dominique Moyen, qui est mis en cause puisqu'il a participé à la création du Comité permanent amiante (CPA), même s'il se défend de l'avoir fait dans un objectif de prévention. Le CPA va tout de même protéger l'utilisation de l'amiante de 1981 à 1997 et surtout s'attribuer progressivement le monopole de l'expertise de l'amiante. "Le CPA a su manipuler les incertitudes scientifiques sur l'amiante, il ne faut plus laisser ce type d'organisation se créer à l'avenir", affirme Gérard Dériot. Une influence qui a entraîné une mauvaise application du décret du 17 août 1977 qui fixe la première valeur moyenne d'exposition.
En ce qui concerne les recours judiciaires, le 28 février 2002, la Cour de cassation a donné une nouvelle définition de la faute inexcusable de l'employeur qui devient un jugement quasiment automatique dans la pratique. "C'est lourd pour l'entreprise, d'autant plus que les assurances ne reconnaissent pas ce jugement", poursuit le sénateur de l'Allier. Ce recours a fortement augmenté puisqu'il est passé de 300 en 2002 à 1.500 en 2004.
La mission sénatoriale propose dans le cadre du suivi médical une meilleure information des salariés pour détecter plus précocement les pathologies. Les auditions ont montré que seule une petite dizaine de salariés ont demandé un examen médical en Ile-de-France et ce faute d'information. Les sénateurs relèvent que les salariés qui procèdent à la maintenance dans des bâtiments qui contiennent encore de l'amiante ne sont pas suffisamment protégés, tout comme ceux qui sont sur des sites de désamiantage. Ils demandent un recensement national de ces lieux consultable sur internet, un recensement des salariés qui travaillant dans le désamiantage et une meilleure application du Dossier technique amiante (DTA). En outre, ils suggèrent que les entreprises qui procèdent au retrait de l'amiante non friable soient assujetties aux mêmes conditions que les sociétés qui retirent de l'amiante friable.
-
Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir
Rapport du Sénat français, 26 octobre 2005.
-
Le drame de l'amiante en France : comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir
Procès-verbaux des auditions, Sénat français, 26 octobre 2005.
Source : Journal de l'Environnement
|