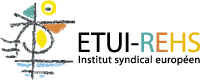|
Peu d’informations sur le poids des facteurs professionnels sur la santé de la population au travail sont actuellement disponibles en France. Afin de pallier en partie cette carence, le Département santé travail de l’Institut de veille sanitaire développe divers systèmes de surveillance épidémiologique de la santé au travail, destinés à fournir régulièrement des indicateurs diversifiés concernant les risques professionnels dans la population française.
C’est dans ce cadre que le Département santé travail a mis en place une analyse systématique et permanente de la mortalité par profession, par secteur d’activité et par cause de décès, dont les premiers résultats sont présentés dans ce document.
Une première étude issue de ce projet permet d’enrichir le débat sur le rôle des conditions de travail dans la production des inégalités sociales de santé.
L’étude Cosmop propose des indicateurs de mortalité par cause et par type d’activité professionnelle. Les résultats obtenus présentent une cohérence globale avec les connaissances scientifiques.
Chez les hommes, le secteur industriel se distingue par une tendance à des excès de mortalité (sauf dans la construction électrique et électronique). Cette surmortalité concerne diversement les pathologies cancéreuses, non cancéreuses et les morts violentes selon l’industrie considérée. Dans le secteur tertiaire en revanche, les hommes présentent plutôt des taux comparables ou inférieurs à ceux des autres secteurs. On notera des exceptions pour le commerce alimentaire et l’hôtellerie-restauration, secteurs dans lesquels on observe des excès de décès par cancer digestif et par certaines pathologies non cancéreuses et morts violentes. Le secteur agricole, quant à lui, se distingue par une sous-mortalité par cancer et par cardiopathie ischémique qui contraste avec des excès de décès observés pour d’autres pathologies non cancéreuses et pour les suicides.
En ce qui concerne les femmes, les résultats sont plus fragiles du fait de leur faible représentation, particulièrement dans les secteurs industriels. On observe chez les femmes une sous-mortalité dans les secteurs de service, à l’exception notable de l’hôtellerie-restauration, comme chez les hommes, et des services domestiques dans lesquels les femmes présentent une surmortalité par pathologie non cancéreuse. Enfin, les écarts de mortalité chez les femmes du secteur agricole présentent des tendances identiques à celles observées chez les hommes, avec une sous-mortalité par cancer et des excès de décès observés par pathologie non cancéreuse et par suicide.
L’échantillon démographique permanent utilisé ici présente des atouts pour ce type d’analyse, notamment en raison de sa représentativité de la population française. Il constitue une source de données régulièrement mise à jour par l’Insee, qui permet d’envisager son utilisation dans un dispositif pérenne de surveillance de la mortalité par profession. Sa taille se révèle pourtant limitée pour mettre en évidence des associations dans des secteurs d’activité peu représentés, pour des causes de décès rares et pour l’étude de la mortalité par profession chez les femmes. Par ailleurs, les hommes et les femmes nés en dehors de la France métropolitaine ont dû être exclus de l’analyse en raison du manque d’exhaustivité des données sur leur statut vital. Or, les données de recensement de l’année 1975 montrent que lorsqu’ils sont nés à l’étranger, les hommes sont plus souvent ouvriers du secteur industriel et les femmes plus souvent employées du secteur tertiaire. Enfin, le nombre relativement important de parcours professionnels incomplets exclut de l’analyse près de 20 % des hommes et des femmes de l’échantillon initial, alors que ces sujets présentent des taux de mortalité plus élevés que ceux au parcours professionnel complet. Des analyses sont en cours afin d’explorer ces différences et la possibilité d’inclure un certain nombre de ces sujets par des techniques statistiques de traitement des valeurs manquantes.
La principale limite de l’échantillon démographique permanent réside dans l’absence d’information sur l’histoire professionnelle des individus au cours des périodes intercensitaires et avant l’année 1968. Ceci conduit à négliger les activités les plus anciennes dans l’histoire professionnelle des sujets les plus âgés et, de plus, ne permet pas d’analyser formellement le risque de décès en fonction du temps réellement passé dans un secteur.
Source: Institut de Veille Sanitaire, Paris
|